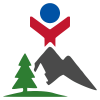Des boutures de saule (Salix) ayant émis de nouvelles racines : un exemple parlant du succès du bouturage, qui permet à partir d’un simple fragment de rameau d’obtenir un nouvel individu végétal.
Qu’est-ce que le bouturage ? Objectifs et avantages
Le bouturage est une méthode de multiplication végétative consistant à reproduire une plante à partir d’un morceau de celle-ci (un fragment de tige, de feuille, de racine, etc.). Concrètement, on prélève une partie d’une plante-mère et on la place dans un milieu adapté afin qu’elle émette des racines et forme une nouvelle plante. Cette nouvelle plante est un clone de la plante-mère, c’est-à-dire qu’elle possède le même patrimoine génétique et les mêmes caractéristiques (feuillage, floraison, fruit...) que celle-ci. À la différence d’un semis qui produit une descendance souvent variée, le bouturage donne donc une descendance homogène et fidèle à la variété d’origine.
Pourquoi bouturer ? Le bouturage présente plusieurs avantages pour le jardinier. D’abord, il permet de multiplier rapidement et à moindre coût un grand nombre de plantes, ce qui est idéal pour étoffer un jardin ou partager des plantes favorites. Ensuite, cette méthode est relativement simple et fiable : on obtient plus facilement de nouveaux individus qu’en semant des graines, car on s’affranchit de l’aléa de la germination et de la pollinisation. Le bouturage offre aussi la possibilité de reproduire à l’identique des plantes particulières (par exemple un rosier ancien, un figuier, une variété de tomate ou une plante d’intérieur précieuse) qui ne se reproduisent pas fidèlement par semis ou dont les graines sont rares/inexistantes. Enfin, il permet de conserver et diffuser des variétés horticoles exactement dans leurs caractéristiques d’origine, ce qui présente un intérêt pour les espèces ornementales ou fruitières qui doivent garder des propriétés spécifiques (couleur, saveur, résistance…). En résumé, le bouturage est un moyen rapide, économique et efficace d’obtenir de nouvelles plantes identiques à la plante-mère.
N.B.: La contrepartie de cette homogénéité clonale est l’absence de brassage génétique : les plantes issues de boutures n’évoluent pas par sélection naturelle et conservent les forces et faiblesses de la plante d’origine. Il faudra donc veiller à bouturer uniquement des pieds sains et vigoureux pour propager ces qualités.
Les différentes techniques de bouturage
Il existe plusieurs techniques de bouturage, selon la partie de plante prélevée et le mode d’enracinement. Les principales stratégies incluent le bouturage de tige, le bouturage de feuille, le bouturage de racine, ainsi que le bouturage en fonction du milieu de reprise (par exemple dans l’eau ou en terre). Chaque méthode a ses spécificités et convient mieux à certaines plantes. Tour d’horizon de ces techniques, avec pour chacune des exemples concrets de végétaux concernés.
Bouturage de tige (bouture simple)

Boutures de romarin (Rosmarinus officinalis) installées en godets : des segments de tige prélevés sur un romarin adulte ont été « piqués » en pot dans un substrat léger pour y émettre des racines.
La bouture de tige est la plus courante et la plus polyvalente des techniques de bouturage. Elle consiste à planter un tronçon de tige prélevé sur la plante-mère, généralement d’une longueur d’environ 10 à 15 cm, en ayant retiré les feuilles basales et coupé la base juste en dessous d’un nœud (c’est-à-dire le point d’attache d’une feuille sur la tige). C’est à ce niveau du nœud que se forment le plus facilement les racines. La bouture ainsi préparée est ensuite mise en terre dans un pot ou une terrine contenant un substrat léger.
Quand pratiquer le bouturage de tige ? Tout dépend de la maturité du bois : on distingue les boutures herbacées (prélevées sur des tiges jeunes encore vertes), les boutures semi-aoûtées (sur des tiges de l’année partiellement lignifiées, c’est-à-dire semi-embuissonnées vers la fin de l’été) et les boutures aoûtées ou ligneuses (sur du bois de l’année bien durci, en automne). En général, on réalise les boutures herbacées au printemps ou tout début d’été, les boutures semi-ligneuses à la fin de l’été (août-septembre) et les boutures ligneuses à l’automne. Ces dernières correspondent souvent à des rameaux de fin de saison ou à du bois sec de l’année qui va entrer en dormance.
Pour quelles plantes ? Le bouturage de tige convient à un très grand nombre de plantes : la majorité des plantes vivaces de massif, des annuelles, de nombreux arbustes à fleurs ou d’ornement et même des arbres peuvent se bouturer ainsi. Quelques exemples : on multiplie couramment par boutures de tige les géraniums (pélargoniums), fuchsias, hortensias, rosiers, chèvrefeuilles, lavandes, romarins, lauriers-roses, etc. Les plantes à massif gélives (géraniums, impatiens, verveines ornementales, fuchsia…) se bouturent de préférence en boutures herbacées au printemps pour pouvoir être replantées en été. Les arbustes persistants (par exemple le laurier-rose, le camélia, le chèvrefeuille arbustif) réussissent bien en boutures semi-aoûtées à la fin de l’été, lorsque leurs tiges commencent à durcir et que la chaleur favorise l’enracinement sans risque de dessèchement excessif. Enfin, de nombreux arbustes à feuilles caduques (rosier, groseillier, viorne, etc.) peuvent se bouturer sur bois aoûté à l’automne : on plante alors le rameau en terre et on attend le printemps suivant pour voir le bourgeonnement, cette méthode demandant un peu de patience.
Variantes sur la bouture de tige : Selon les espèces, on peut affiner la technique de base pour améliorer la reprise. Par exemple, la bouture « en talon » consiste à arracher une petite branche secondaire en lui laissant un morceau d’écorce ou de bois du rameau principal d’où elle partait (ce « talon » cicatriciel favorisera l’émission de racines). Cette méthode est prisée pour les vivaces à tiges semi-ligneuses (romarin, lavande…), les rosiers, certains conifères et arbustes (forsythia, lilas, sureau, vignes, etc.). La bouture « en crossette » est une variante où l’on conserve carrément un segment d’environ 1,5 cm de la branche principale attaché à la bouture, formant une petite crosse : utile pour les plantes à tiges creuses ou lentes à s’enraciner (figuier, spirée, sureau, etc.). Enfin, la bouture d’œil utilise un très court fragment de rameau (2-5 cm) avec un seul bourgeon axillaire ; on peut ainsi obtenir de nombreuses boutures sur une seule branche, mais leur développement est long – on réserve cela par exemple au camélia, au rhododendron ou à la vigne.
Bouturage de feuille

Bouture de feuille réussie de Saintpaulia (Violette africaine) : de jeunes plantules se forment à la base de la feuille mère, démontrant la capacité de certaines feuilles charnues à régénérer une plante entière.
Le bouturage de feuille exploite la capacité de régénération de certaines plantes à feuilles charnues ou pubescentes. Il s’agit de prendre soit une feuille entière (parfois avec son pétiole), soit un morceau de feuille, puis de le placer sur un substrat humide pour provoquer l’apparition de racines et de bourgeons. Il existe plusieurs manières de procéder : certaines espèces se bouturent à partir d’une feuille entière simplement posée sur le sol (après avoir incisé légèrement les nervures principales pour stimuler l’émission de rejets), d’autres à partir d’une portion de feuille découpée comprenant une nervure principale, ou encore à partir d’une feuille plantée verticalement dont seule la base trempe dans le substrat (cas de plantes à pétiole charnu par ex.).
Pour quelles plantes ? Ce mode de bouturage concerne surtout des végétaux aux feuilles épaisses ou succulentes. Parmi les classiques : la Violette du Cap (Saintpaulia) se multiplie aisément par bouture de feuille entière avec pétiole ; de nombreuses plantes grasses et succulentes (sédums, echevérias, crassulas, sansevières, etc.) forment des plantules à partir de simples feuilles posées sur du terreau légèrement humide. On peut aussi bouturer des feuilles de bégonias rex (on incise les nervures au revers de la feuille et on la maintient plaquée sur le terreau : des plantules naissent aux endroits incisés), des fuchsias ou des pourpiers d’ornement, etc.. En intérieur, les plantes d’appartement à feuillage charnu comme le Zanzibar gem (Zamioculcas), certaines succulentes ou cactus de Noël, se prêtent bien à ce type de multiplication.
Quand ? De manière générale, le bouturage de feuille peut se pratiquer toute l’année en intérieur pour les plantes persistantes ou d’intérieur, à condition de leur offrir chaleur et humidité. Il est toutefois souvent plus efficace pendant les périodes de végétation active (printemps et été) qui stimulent la croissance.
Remarque : Le bouturage de feuille demande parfois un peu de patience. Le développement des nouvelles plantules peut être lent (plusieurs semaines à mois avant de voir apparaître des racines ou des rejets selon l’espèce). Il faut veiller à ne pas trop arroser (pour éviter la pourriture de la feuille-bouture) et à maintenir une bonne humidité ambiante.
Bouturage de racine
Le bouturage de racine consiste, non pas à faire émettre des racines à une tige, mais à faire émettre des pousses (bourgeons) à… une racine ! On prélève pour cela un segment de racine jeune et vigoureuse sur la plante-mère (généralement une racine charnue d’assez gros diamètre), et on le replante dans un substrat adapté. Cette racine “plantée” va alors développer des bourgeons et donner naissance à un nouveau plant.
Pour quelles plantes ? Cette méthode s’applique aux plantes vivaces ou arbustes qui ont des racines suffisamment charnues et capables de drageonner. Par exemple, on peut multiplier par boutures de racines certaines vivaces herbacées telles que la molène (Verbascum), les pavots vivaces, les phlox paniculés, ou encore des arbustes drageonnants (qui font naturellement des rejets à partir des racines) comme certains ronces ornementales, spirées ou suckers (drageons de lilas, etc.). C’est aussi une technique employée pour régénérer des plantes potagères vivaces comme la rhubarbe ou l’artichaut, et pour multiplier des fleurs comme le chrysanthème ou l’oeillet qui peuvent émettre des rejets racinaires.
Quand ? Le bouturage de racines se pratique de préférence en hiver, lorsque la plante-mère est en repos végétatif. On profite souvent de la saison creuse (décembre à février) pour déterrer délicatement la plante mère, sectionner quelques morceaux de racines de 5 à 10 cm de long, puis la replanter (elle-même ne souffrira pas trop de l’opération en cette période). Les tronçons de racines prélevés sont ensuite mis en pot, à l’horizontale sous une légère couche de substrat, ou à la verticale (en respectant le sens haut/bas de la racine, souvent on coupe le haut bien droit et le bas en biseau pour les distinguer). Au printemps suivant, de jeunes pousses devraient émerger si tout va bien.
Avantages et inconvénients : Le bouturage de racines est simple à réaliser et ne requiert pas de soins particuliers complexes (pas de gestion de l’évaporation foliaire, etc., puisque il n’y a pas de feuilles pendant l’enracinement). En revanche, on ne peut généralement pas obtenir un grand nombre de boutures de chaque plante-mère sans l’affaiblir : il faut prélever parcimonieusement pour ne pas endommager le système racinaire initial.
Bouturage dans l’eau

Bouturage dans l’eau – ici des tiges de basilic vivace et de saule trempées dans des verres d’eau, où l’on peut observer l’apparition de racines blanches : cette méthode simple permet de voir la formation des racines en direct, mais nécessite ensuite un transfert délicat en pot.
Le bouturage dans l’eau est une technique populaire et ludique, notamment auprès des jardiniers débutants. Elle consiste à placer une bouture (généralement un segment de tige verte d’une plante) dans un récipient rempli d’eau, afin qu’elle y émette des racines. De nombreuses plantes produisent très facilement des racines dans l’eau, ce qui permet de constater rapidement la réussite de l’opération.
Pour quelles plantes ? Ce mode de bouturage convient surtout à des espèces herbaceées et tropicales. Par exemple, la plupart des plantes d’intérieur à tiges vertes s’y prêtent bien : bégonias à tige, pothos (Scindapsus), philodendrons, misère (Tradescantia), coleus, syngoniums, pilea… On peut aussi bouturer dans l’eau de jeunes rameaux de papyrus, de lierre, de chlorophytum (plante araignée), ou encore des boutures d’herbes aromatiques tendres comme le basilic, la menthe, le thym citron, etc. Même certaines boutures d’arbustes fonctionnent dans l’eau : un classique est la bouture de laurier-rose dans un vase d’eau, ou encore des tiges de saule ou de peuplier dont l’eau va extraire l’acide salicylique aux propriétés enracinantes naturelles.
Quand ? Plutôt aux beaux jours (printemps/été), car la chaleur accélère l’émission de racines dans l’eau. On évite en revanche de faire des boutures dans l’eau en hiver (l’eau froide stagnante pourrait faire pourrir la tige avant qu’elle n’enracine).
Précautions : Bien que facile, le bouturage dans l’eau présente deux écueils. D’une part, il ne convient pas à toutes les plantes : les végétaux ligneux ou succulents, par exemple, n’y sont pas adaptés (on ne bouture jamais les cactus ou plantes grasses dans l’eau, et les arbustes de jardin s’enracinent rarement en milieu aquatique). D’autre part, le repiquage de la bouture en terre peut être délicat : les racines « d’eau » qui se forment sont souvent fragiles et peu ramifiées, et la bouture peut souffrir lors du passage au substrat solide. Il est conseillé de transporter la bouture en pot dès l’apparition des premières racines de quelques centimètres, sans attendre qu’elles s’allongent trop. On changera régulièrement l’eau (tous les 5-7 jours) pour éviter le pourrissement, éventuellement en ajoutant un petit morceau de charbon de bois pour garder l’eau saine. Après transfert en pot, on surveille bien l’humidité du terreau pour aider la jeune plante à s’adapter.
Bouturage en terre (en substrat)
Le bouturage en terre désigne la méthode classique où la bouture est mise à raciner dans un substrat solide (terre, terreau, sable, etc.), par opposition au milieu purement aquatique. C’est en réalité le mode de bouturage le plus répandu et qui recouvre des situations variées : boutures effectuées en pot ou en terrine avec un terreau léger, ou même boutures réalisées en pleine terre au jardin pour certaines espèces robustes.
Substrat et récipient : Pour réussir un bouturage en terre, le choix du substrat est crucial. Il doit être léger, drainant et propre, afin de maintenir assez d’humidité pour la bouture sans provoquer de pourriture. On utilise classiquement un mélange moitié terreau de feuilles (ou terreau universel fin) et moitié sable grossier. On peut aussi acheter des terreaux “spécial semis et bouturage” prêts à l’emploi, ou incorporer de la perlite ou de la vermiculite au terreau pour l’alléger. Le récipient importe peu : on peut bouturer en godets individuels, en pots en terre cuite, en caissette ou même en pleine plate-bande. Il faut juste qu’il y ait un bon drainage (trous au fond) et que le contenant ne soit pas trop profond (5 à 10 cm de profondeur de substrat suffisent généralement). Si on bouture directement en pleine terre (ce qui se fait pour certaines boutures ligneuses hivernales, voir plus bas), on prépare le sol en l’ameublissant bien et en y mélangeant un peu de sable pour l’alléger.
Exemples de bouturage en pleine terre : Certaines espèces ligneuses se bouturent si facilement qu’on peut les planter directement en extérieur, où elles prendront racine. C’est le cas par exemple du saule, du peuplier ou du figuier : on peut en automne couper des sections de rameaux bien droits, de 20 à 30 cm de long (boutures en plançon), et les planter dehors à l’endroit voulu (ou en jauge). Ils émettront des racines au printemps suivant et donneront de nouveaux plants. De même, des boutures de groseilliers ou de rosiers faites en octobre-novembre directement en terre peuvent réussir, à condition de les protéger du gel trop intense. Cependant, bouturer en pleine terre expose plus aux aléas climatiques (gel, sécheresse), c’est pourquoi on préfère souvent bouturer en pot ou en mini-serre, puis repiquer en pleine terre une fois la bouture bien enracinée.
Conditions idéales pour réussir un bouturage
La réussite d’un bouturage tient autant à la technique de prélèvement qu’aux conditions environnementales offertes à la bouture pour s’enraciner. Voici les paramètres clés à maîtriser :
Période de prélèvement : La période idéale dépend de l’espèce et du type de bouture, mais en général il est préférable d’intervenir au début de la saison de croissance de la plante. Beaucoup de boutures prennent mieux au printemps ou en début d’été lorsque la plante est en pleine activité, qu’en fin de saison ou en période de dormance. (Les exceptions existent : par ex. les boutures de bois sec se font en hiver sur bois dormant, voir calendrier plus loin.)
Sélection du matériel : Toujours prélever sur une plante-mère saine, vigoureuse, non porteuse de maladies ou parasites. Évitez les tiges qui portent déjà des fleurs ou des fruits : si c’est le cas, supprimez-les, car ils épuiseraient inutilement la bouture. De même, préférez des rameaux ni trop jeunes ni trop vieux : une pousse de l’année semi-aoûtée convient bien pour beaucoup d’arbustes. La bouture prélevée doit mesurer en général 10 à 15 cm (pour une tige) et comporter au moins 2 ou 3 nœuds/bourgeons.
Outils et coupe : Utilisez un sécateur ou couteau bien affûté et désinfecté (à l’alcool) pour faire des coupes nettes, afin de minimiser les blessures et les infections. La coupe inférieure doit être faite juste sous un nœud (zone où se concentrent les hormones d’enracinement) et idéalement en biseau (angle ~45°) pour augmenter la surface d’enracinement. Pour les boutures de racines, on coupe la racine-mère du côté proche de la souche bien droit, et l’extrémité éloignée en biseau, afin de distinguer le sens de plantation. Supprimez les feuilles basses sur les boutures de tige, ne conservez qu’un petit toupet de feuilles au sommet (éventuellement en réduisant de moitié les grandes feuilles pour limiter l’évaporation). Enlevez aussi les épines sur la partie basse si c’est une plante épineuse.
Substrat : Comme évoqué, le substrat doit être léger, aéré et propre. Un mélange terreau + sable ou terreau + perlite est idéal. Évitez absolument les terreaux riches non drainants ou la terre de jardin lourde, qui favorisent les pourritures et l’asphyxie – c’est une erreur classique d’utiliser un terreau inadapté.
Humidité et arrosage : Une bouture doit être maintenue dans une atmosphère humide mais non détrempée. Arrosez délicatement le substrat juste après le repiquage (idéalement avec un brumisateur ou un arrosoir à pomme fine). Ensuite, gardez le terreau légèrement humide en permanence, sans excès d’eau. Un substrat trop sec fera flétrir la bouture qui n’a pas de racines pour pomper l’eau ; à l’inverse, un excès d’eau provoque des moisissures et la base de la bouture risque de pourrir (des feuilles qui jaunissent, brunissent ou ramollissent sont signe d’un excès d’arrosage). Pour maintenir une bonne hygrométrie, on peut recouvrir la bouture d’une cloche transparente ou d’un sac plastique perforé, créant un effet de serre (bouturage à l’étouffée). Cette mini-serre maison garde près de 100% d’humidité autour de la bouture, ce qui favorise l’enracinement surtout par temps chaud et sec. Attention toutefois à aérer de temps en temps (au moins une fois par semaine) pour éviter le développement de moisissures sous la cloche. Et ne placez pas une bouture « à l’étouffée » en plein soleil : l’effet de serre ferait grimper la température et « cuirait » la bouture.
Température : La chaleur douce stimule l’enracinement. La plupart des boutures apprécient une température autour de 20-25°C. En dessous de 15°C l’enracinement sera très lent (sauf pour les boutures de bois sec hivernales qui se contentent du froid saisonnier). En intérieur, placez les boutures dans une pièce tempérée à l’abri des courants d’air froid. En extérieur, en été, évitez les emplacements brûlants ; à l’automne ou en hiver, abritez les boutures du gel (utilisez une serre froide ou rentrez les pots hors gel si nécessaire).
Lumière : Une bouture a besoin de lumière pour former ses racines (car même sans racines, les feuilles continuent la photosynthèse qui fournit l’énergie nécessaire). Cependant, il faut impérativement éviter le soleil direct, surtout aux heures chaudes, tant que la bouture n’a pas de racines pour alimenter ses feuilles en eau. Installez les boutures en lumière vive tamisée ou à mi-ombre claire. Par exemple, derrière une fenêtre bien éclairée mais voilée d’un rideau, ou dehors à l’ombre légère d’un arbre. Un manque de lumière se traduit par une bouture qui végète ou jaunit, donc veillez à offrir suffisamment de luminosité naturelle indirecte.
Hormones d’enracinement : L’usage d’hormone de bouturage (auxine) n’est pas obligatoire mais peut améliorer le taux de réussite, surtout sur les espèces un peu difficiles (certaines plantes ligneuses, conifères, fruitiers, etc.). On trouve en jardinerie des poudres d’hormones : il suffit d’humidifier la base de la bouture et de la tremper légèrement dans la poudre, puis de tapoter pour ôter l’excédent. Une fine couche d’hormones au bas de la bouture stimulera la formation de racines. Il existe aussi des alternatives naturelles souvent citées par les jardiniers : l’eau de saule (obtenue en faisant macérer des morceaux de branches de saule dans de l’eau, riche en acide salicylique aux propriétés rhizogènes), le miel, la cannelle ou même le lait de coco. Leurs effets sont variables mais sans risque pour la bouture. Dans tous les cas, avec ou sans hormones, la clé est surtout de prélever au bon moment sur un tissu encore suffisamment jeune et de soigner les conditions autour de la bouture.
Patience et vigilance : Une bouture met généralement plusieurs semaines à s’enraciner, parfois quelques mois. Évitez de la déranger pendant ce temps. On peut vérifier la reprise en observant l’apparition de nouvelles feuilles/pousses au niveau des bourgeons (signe que la bouture a formé des racines actives). Si rien ne bouge en surface, on peut tester après quelques semaines en tirant légèrement sur la bouture : si elle résiste, c’est qu’elle commence à tenir au substrat grâce aux racines. Une fois que de bonnes racines se sont développées, on pourra rempoter la nouvelle plante dans un terreau plus nourricier pour poursuivre sa croissance. D’ici là, surveillez qu’aucun champignon (moisissure) ne se développe sur la tige ou le sol ; si besoin, découvrez la bouture et traitez légèrement à la cannelle (antifongique naturel) les zones atteintes.
Calendrier : quand bouturer quelles plantes ?
Le calendrier optimal de bouturage dépend du cycle de chaque plante et du type de bouture envisagé. Voici un aperçu saisonnier des périodes favorables, assorti de quelques exemples de plantes à bouturer à ces moments-là :
Printemps (mars à juin) – C’est la grande période des boutures herbacées sur les pousses tendres du printemps. Dès mars-avril (selon climat), on peut bouturer de nombreuses vivaces et annuelles gélives avant la floraison. Par exemple, on réalise au printemps des boutures sur des plantes de massif comme le géranium, le fuchsia ou le chrysanthème, juste après leur reprise de végétation. En mai-juin, on peut prélever des jeunes tiges encore vertes sur quantité d’arbustes et de plantes d’intérieur : c’est le bon moment pour bouturer les plantes aromatiques (menthe, sauge…), les pélargoniums (géraniums), les hortensias après débourrement, les dahlias avant floraison, etc.. Début juin, par exemple, convient bien aux boutures de feuillus comme l’érable ou l’azalée, sur des pousses de l’année à peine durcies.
Été (juillet à mi-septembre) – En été, la chaleur permet d’obtenir un enracinement rapide, mais il faut éviter le plein soleil. C’est la période des boutures semi-aoûtées (rameaux de l’année partiellement lignifiés, feuilles matures à la base et jeunes en pointe). De mi-juillet à fin août, on bouture par exemple les arbustes à feuillage persistant (lavande, romarin, buis, laurier-rose…), qui profitent de la chaleur tout en ayant moins de risque de dessèchement en fin d’été. On peut également bouturer en été de nombreuses plantes d’intérieur et tropicales (pothos, dieffenbachia…) qui apprécient l’étouffée. Août est propice aux boutures sur du bois plus durci (boutures aoûtées) pour certaines espèces : on peut bouturer à ce moment des rosiers (de préférence « à l’étouffée » sous plastique) ou des arbustes à floraison estivale après floraison (par ex. lilas des Indes – Lagerstroemia, ciste, bignone). En climat chaud, on attend parfois début septembre pour profiter de nuits plus fraîches tout en ayant encore une bonne chaleur diurne pour bouturer des plantes comme le camélia, le gardénia ou le chlorophytum.
Automne (mi-septembre à novembre) – À l’automne, la végétation ralentit puis entre en dormance, mais on peut effectuer des boutures de fin de saison. C’est la période favorable aux boutures de bois aoûté (bois bien durci de l’année) et aux boutures dites de bois sec (rameaux dormants prélevés juste avant ou pendant l’hiver). Par exemple, en septembre-octobre on réussit bien les boutures de rosier, de sureau, de vigne vierge, de chèvrefeuille d’hiver ou d’hortensia. On prépare aussi en automne des boutures de racines sur les vivaces qui se déterrent à cette saison, ou des boutures en plançon sur des arbustes caducs comme le cassissier, le groseillier ou la vigne (on coupe des sections de rameaux lignifiés en novembre, que l’on plantera directement en extérieur ou qu’on mettra en jauge jusqu’à la fin de l’hiver).
Hiver (décembre à février) – En plein hiver, la plupart des plantes sont en repos, mais c’est le bon moment pour les boutures de bois sec sur les arbres et arbustes caducs. On prélève sur les sujets dormants des tronçons de rameaux lignifiés d’environ 20 cm qu’on plantera dehors ou en pot à l’abri du gel. Par exemple, on peut bouturer en hiver le peuplier, le saule, le figuier (sous abri), le groseillier, le framboisier, ou encore le rosier (boutures de novembre-décembre). Les conifères se bouturent pour leur part plutôt en fin d’automne et durant l’hiver également, mais de préférence sous châssis froid (ex : boutures de thuya ou de cyprès en novembre). L’hiver est aussi idéal pour pratiquer le bouturage de racines sur les vivaces épaisses comme la pivoine ou l’acanthe – on en profite car la plante est au repos et on aura des rejets au printemps suivant sans compromettre la floraison de l’année en cours.
Bien entendu, ce calendrier reste indicatif. La réussite dépend beaucoup des conditions climatiques locales et de la plante concernée. En intérieur, on peut bouturer hors saison en maintenant artificiellement chaleur et lumière. En extérieur, il faut adapter le calendrier au rythme de chaque espèce : par exemple, on bouturera un forsythia juste après sa floraison de mars (boutures de printemps sur tiges défleuries), un lavandin en août (boutures semi-aoûtées estivales), un rosier buisson plutôt en octobre (bouture de bois sec automnale). Renseignez-vous espèce par espèce pour optimiser le timing.
Erreurs courantes à éviter
Même si le bouturage est simple en principe, certaines erreurs peuvent compromettre vos efforts. Voici les pièges à éviter pour ne pas voir vos boutures dépérir :
Bouturer au mauvais moment ou sur le mauvais tissu : Évitez de bouturer en période de dormance (sauf cas particuliers) ou en pleine canicule. Respectez les saisons indicatives vues plus haut. Ne prélevez pas de boutures sur du bois trop vieux ou déjà florifère. Par exemple, bouturer une tige en pleine floraison est une erreur : les fleurs consommeraient l’énergie au détriment des racines, il vaut mieux bouturer une tige en croissance végétative sans fleurs.
Utiliser des segments mal choisis : Ne prenez pas de boutures sur une plante malade, affaiblie ou parasitée, car les chances de reprise sont faibles et vous risquez de propager les problèmes. De même, ne bouturez pas n’importe quelle partie : une tige trop fine (extrémité molle) ou trop épaisse (vieux bois dur) reprendra moins bien qu’un rameau demi-mûr. Privilégiez toujours du matériel sain et vigoureux.
Faire une coupe approximative : La manière de couper influence grandement la réussite. Il ne faut ni écraser ni mâchonner la tige lors de la coupe. Une erreur courante est d’utiliser un outil mal affûté qui écrase les tissus. Au contraire, faites une coupe nette et propre en dessous d’un nœud sur la tige. Si la coupe est bâclée (tige fendue, longueur excessive sans nœud, etc.), la bouture aura du mal à émettre des racines. Pour les racines, respectez le sens (ne pas replanter la racine à l’envers).
Laisser trop de feuillage ou d’organes sur la bouture : Une bouture fraîchement plantée ne peut pas nourrir beaucoup de feuilles. Il est donc impératif de supprimer les feuilles inférieures et de ne garder que quelques petites feuilles en haut. Ne pas le faire (ou laisser des feuilles qui trempent dans le substrat) entraînera souvent le pourrissement ou le flétrissement. De même, retirez fleurs, boutons floraux, et réduisez la taille des grandes feuilles de moitié. Pour les boutures ligneuses, on peut aussi scarifier légèrement l’écorce à la base (entaille superficielle) pour favoriser l’émission de racines, mais sans abîmer le rameau.
Bouturer dans un mauvais milieu : Un substrat inadapté est fatal. Planter des boutures dans un terreau lourd et détrempé est une erreur classique : la bouture risque de ne « jamais prendre » car elle va pourrir avant d’enraciner. N’utilisez pas non plus de l’eau stagnante non renouvelée pour les boutures d’eau – changez-la régulièrement. Enfin, n’exposez pas les boutures en pot aux pluies battantes : un substrat détrempé asphyxie les boutures.
Oublier l’arrosage… ou trop arroser : Un juste milieu est à trouver. Ne laissez jamais une bouture se dessécher complètement (le flétrissement irréversible peut survenir en quelques heures pour une petite bouture feuillue). À l’inverse, arroser excessivement est tout aussi néfaste : l’excès d’eau provoque des feuilles jaunies/molles et des nécroses. La terre doit rester fraîche mais jamais saturée d’eau.
Manque d’hygrométrie ou excès de soleil : Planter ses boutures et les abandonner en plein soleil sans protection est une erreur fréquente. Sous un soleil ardent, une bouture non enracinée va se déshydrater très vite et périr. Placez-les toujours à la mi-ombre, à l’abri du vent et du soleil direct. Inversement, ne les placez pas non plus dans un recoin sombre : sans lumière, elles ne feront pas de racines. Si vous utilisez une cloche ou un sac plastique (bouturage à l’étouffée), méfiez-vous de l’effet de serre en plein soleil : la température grimpe et « cuit » la plante.
Ne faire qu’une seule bouture : Même avec les meilleurs soins, il arrive qu’une bouture ne prenne pas (aléas naturels). Si vous ne faites qu’un seul essai, le risque d’échec est plus grand. Prélevez toujours plusieurs boutures à la fois sur la plante-mère (quitte à en donner ensuite si vous en avez trop) : en multipliant les tentatives, vous augmentez vos chances de succès.
Impatiemment déranger la bouture : Évitez de tirer sur la bouture tous les jours pour voir si ça tient ! Chaque manipulation peut endommager les frêles racines naissantes. De même, ne la rempotez pas trop vite. Attendez des signes clairs de reprise (poussée de nouvelles feuilles, bonne résistance à une traction légère) avant de transférer la bouture dans un pot plus grand ou de la mettre en pleine terre. Trop d’empressement peut casser les racines ou choquer la plante.
En évitant ces erreurs communes, vous maximisez les chances de voir vos boutures se transformer en plantes bien portantes.
Astuces et conseils pour réussir vos boutures
Pour finir, voici quelques astuces de jardinier qui augmentent le taux de réussite des boutures et facilitent le bouturage au quotidien :
Prélevez le matin de préférence. Les plantes sont mieux hydratées le matin qu’en fin de journée chaude, vos boutures seront plus turgescentes et résisteront mieux au stress de la coupe.
Gardez les boutures au frais avant le bouturage. Si vous ne pouvez pas repiquer immédiatement, mettez les boutures dans un linge humide à l’ombre, ou dans un seau d’eau fraîche (pour des tiges) le temps de les préparer. Ne les laissez pas se dessécher au soleil.
Respectez le sens de plantation. Ça peut paraître évident, mais il faut planter la bouture dans le bon sens (surtout valable pour les boutures de racines ou de tiges sans feuilles). Un truc : coupez toujours la base en biseau et le haut de la bouture bien droit, pour les distinguer du premier coup d’œil.
Poudre de cannelle contre les infections. La cannelle en poudre est un antifongique naturel. Saupoudrez-en un peu sur la plaie de coupe de la bouture (surtout pour les boutures de feuilles ou de succulentes) pour éviter les champignons.
Laissez cicatriser les boutures de succulentes. Pour les plantes grasses, cactus et succulentes, ne plantez pas la bouture immédiatement. Après la coupe, laissez la bouture de feuille ou de tige sécher à l’air libre pendant 1 à 2 jours : la plaie va se cicatriser (cal), ce qui empêchera la pourriture une fois en terre. Ensuite seulement, placez-la sur le substrat légèrement humide.
Utilisez de l’« eau de saule ». Si vous avez des saules à portée, faites macérer quelques petites branches de saule dans de l’eau pendant 24-48h. Utilisez cette eau riche en hormones naturelles pour arroser vos boutures ou même y faire tremper la base des boutures quelques heures avant de planter. C’est un stimulant racinaire bien connu des jardiniers.
Choisissez bien vos pots. Les pots en terre cuite sont souvent recommandés car leurs parois gardent la chaleur et assurent une certaine respiration du substrat, ce qui favorise l’émission des racines. Si vous utilisez des godets en plastique, veillez d’autant plus au drainage. Une astuce pour multiplier en série : une simple barquette en polystyrène (du type caissette de marché) remplie de sable et terreau fait un excellent bac à boutures ; vous y piquez une vingtaine de boutures d’un coup, que vous repiquerez individuellement plus tard.
Serrez les boutures au bord du pot. Plantez les boutures près du bord du pot plutôt qu’au centre : la paroi du pot, en particulier en terre cuite, emmagasine et restitue de la chaleur, ce qui stimule la rhizogenèse sur le côté de la motte. De plus, en périphérie le drainage est meilleur qu’au centre du pot.
Étiquetez vos boutures. Notez le nom de la plante et la date de bouturage sur une étiquette plantée dans le pot. C’est très utile quand on multiplie beaucoup de variétés à la fois, pour suivre les réussites et échecs, et se rappeler quand on les a faites (surtout si l’on doit hiverner des boutures non encore reprises).
Multipliez les chances en testant plusieurs méthodes. Vous hésitez entre l’eau et la terre ? Essayez les deux en parallèle avec plusieurs boutures ! Parfois, une même plante peut mieux prendre dans l’eau chez l’un et en terre chez l’autre. De même, n’hésitez pas à utiliser un peu d’hormone de bouturage sur certaines boutures et pas sur d’autres pour comparer. Chaque plante et chaque condition de culture étant unique, l’expérimentation est la meilleure alliée du jardinier.
En suivant ce guide et en étant attentif aux besoins de vos boutures, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir vos bouturages, que vous soyez débutant enthousiaste ou jardinier averti. Avec de la pratique, cette technique de multiplication végétative n’aura plus de secrets pour vous, et vous pourrez ainsi enrichir votre jardin et votre maison de nouvelles plantes issues de vos propres boutures !
Toutes les sources